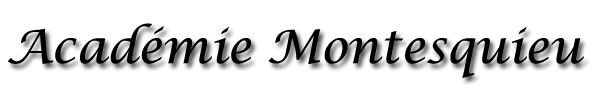Monsieur le Maire, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je voudrais dire une émotion et une gratitude d’autant plus vives que ce prix dont vous m’honorez porte le nom de Montesquieu et qu’il émane de ce qu’on a justement nommé « le port des Lumières ». Cette rive du fleuve qui a été fixée deux fois par les pinceaux de Claude-Joseph Vernet, sous un ciel lumineux ou bien chargé, apparaît à la fois comme un paysage qu’admirent les promeneurs et comme un lieu de commerce que des travailleurs animent. Les fines silhouettes des navires disent les voyages et les échanges, le trafic des marchandises, le mouvement des personnes et des idées. Du mouvement des idées, Montesquieu est un animateur et un témoin privilégié. Durant l’été, Donald Tusk, président du Conseil européen, a vanté l’auteur de L’Esprit des lois contre les autres philosophes français des Lumières : « En Europe, nous avons trop de Rousseau et de Voltaire, et trop peu de Montesquieu. » On ne peut que se réjouir de voir ces noms dans la bouche d’un responsable européen, mais l’opposition établie entre eux mérite qu’on s’y arrête. Montesquieu se situerait du côté du pragmatisme, Rousseau et Voltaire, réconciliés pour l’occasion, se caractériseraient par une dérive critique. Montesquieu observerait les usages et les mœurs que dénonceraient Voltaire et Rousseau auxquels on peut adjoindre Diderot. Une telle division ne risque-t-elle pas d’appauvrir le message des Lumières ? Les diatribes anticléricales du Dictionnaire philosophique ne doivent pas êtres isolées des enquêtes historiques de Voltaire et de sa curiosité pour les autres cultures. La radicalité théorique du Contrat social n’est pas plus séparable du respect des situations particulières, que ce soit celles de Pologne ou de la Corse pour lesquelles Rousseau écrit des projets de constitution. La dissidence matérialiste et athée de Denis Diderot va de pair avec la lente et scrupuleuse collecte informative de l’Encyclopédie. Réciproquement, le sens du bariolage des sociétés humaines dans L’Esprit des lois ne désamorce nullement la juvénile machine infernale que sont les Lettres persanes, pas plus que le questionnement audacieusement ouvert par le recueil manuscrit de Mes pensées.
Le plaisir demeure entier à plonger dans le jeu d’échos qu’organise le roman épistolaire de 1721. La satire de l’Occident par l’Orient et de l’Orient par l’Occident se complique de renvois entre tyrannie politique et despotisme domestique. La négation des droits de sujets qui se rêvent citoyens se retrouve dans la négation des droits des femmes. La subtilité du romancier des Lettres persanes est de faire miroiter le sens de son texte, en en multipliant les complications. Il dédouble le regard étranger dans les deux figures de Persans. Il y a Usbek, l’homme mûr, le maître d’un sérail, arc-bouté sur son droit à asservir ses femmes et certain d’être aimé et désiré par sa favorite, et il y a Rica, je jeune homme, moins dépendants les coutumes de son pays, plus libre dans ses jugements, plus attentif à ce qu’il découvre en France et mieux prêt à s’interroger et à engager le débat. Usbek a laissé son sérail à la garde des eunuques auxquels il délègue un pouvoir caricatural, vidé de son sens, devenu pure tyrannie. Il prétend que ses femmes vivent comme s’il se trouvait encore parmi elles. Il ne peut accepter que la moindre d’entre elles s’expose « à des regards, que dis-je à des regards ? peut-être aux entreprises d’un perfide […] » (lettre xx). Il répète quelques lettres plus loin à Roxane qui, à ses yeux , incarne la pureté, parce qu’elle demeure enfermée « dans le séjour de l’innocence, inaccessible aux attentats de tous les humains » : « Jamais homme ne vous a souillée de ses regards […] » (xxvi). Par contraste avec cette réclusion où sont maintenues les femmes orientales, l’Occident ne serait ne serait qu’impudeur : « Les femmes y ont perdu toute retenue : elles se présentent devant les hommes à visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite » (id.).
Le premier eunuque renchérit sur cette exigence du voile. Il n’accepte de faire voyager les femmes d’Usbek que sous une véritable bâche supplémentaire. L’une d’elles se plaint : « Il joignit à la toile qui nous empêchait d’être vues un rideau si épais que nous ne pouvions absolument voir personne » (xlvii). Cette violence parmi d’autres révolte le sérail. Elle mine l’autorité des eunuques qui ne peuvent répondre que par des coups et finalement par le meurtre. Rica, lui, s’interroge : « C’est une grande question, parmi les hommes, de savoir s’il est plus avantageux d’ôter aux femmes la liberté que de la leur laisser ; il me semble qu’il y a bien des raisons pour et contre » (xxxviii). Quelques lettres plus loin, il expose le point de vue français : « Toutes les sages précautions des Asiatiques, les voiles qui les couvrent, les prisons où elles sont détenues, la violence des eunuques leur paraissent des moyens plus propres à exercer l’industrie de ce sexe qu’à la lasser. » (lv). L’industrie de ce sexe, c’est-à-dire l’ingéniosité des femmes à déjouer la surveillance qui s’exerce sur elles et à tromper leurs geôliers. Rica ne voit encore qu’un libertinage généralisé comme suite du refus du voile et de la claustration, mais il prend peu à peu conscience que les hommes ne peuvent être libres dans un système où les femmes ne le sont pas. Il avoue bientôt à son ami Usbek :
« Mon esprit perd insensiblement tout ce qui lui reste d’asiatique, et se plie sans effort aux mœurs européennes. Je ne suis plus si étonnée de voir dans une maison cinq ou six femmes avec cinq ou six hommes, et je trouve que cela n’est pas mal imaginé. / Je le puis dire : je ne connais les femmes que depuis que je suis ici, j’en ai plus appris dans un mois que je n’aurais fait en trente ans dans un sérail » (lxiii).
Il va jusqu’à transmettre à son correspondant un conte qui semble une mise en abyme de tout le roman. C’est une fiction qui inverse les rôles masculins et féminins pour forcer à mettre en question les préjugés et la tradition. Le conte se présente comme un emboîtement de récits, à la façon dont le romantisme allemand affectionne les rêves au second degré. Il invite ainsi à des glissements progressifs vers moins de réalité et plus de liberté. Rica raconte l’histoire d’une femme savante et décomplexée, Zuléma, qui a lu les textes religieux et qui récuse un paradis, dont profiteraient les hommes seuls. Elle rapporte elle-même, histoire dans l’histoire, les aventures qui se déroulent dans le sérail d’un tyran, Ibrahim, n’hésitant pas à tuer une femme révoltée par sa violence. Anaïs, c’est le nom de celle-ci, découvre après sa mort un paradis, « rempli d’hommes célestes destinés à ses plaisirs » (cxli). Deux d’entre eux se mettent aussitôt à sa disposition : « C’est alors qu’elle fut enivrée, et que ses ravissements passèrent même ses désirs. » Le lendemain matin, elle visite son sérail où elle voit « cinquante esclaves d’une beauté miraculeuse ». Elle profite des plaisirs qui lui sont proposés, mais n’oublie pas pour autant ses compagnes sur terre. Sa jouissance individuelle n’est pas égoïste et n’efface pas le souvenir de la violence faite aux femmes. Elle décide de leur venir en aide.
« Elle donna ordre à un de ces jeunes hommes qui étaient auprès d’elle de prendre la figure de son mari, d’aller dans son sérail, de s’en rendre maître, de l’en chasser, et d’y rester à sa place jusqu’à ce qu’elle le rappelât. » Le faux Ibrahim s’installe donc et sait vite se faire aimer de toutes. « Il congédia tous les eunuques, rendit sa maison accessible à tout le monde ; il ne voulut pas même souffrir que ses femmes se voilassent. » Le véritable Ibrahim peut bien revenir, arguer de son bon droit, brandir sa légitimité ; jamais les choses ne seront plus comme avant. Le monde renversé n’est pas une simple parenthèse carnavalesque vite refermée, un jeu paradoxal où l’on s’amuse de voir les hiérarchies inversées. Il devient une expérience qui laisse songer à une transformation irréversible de la réalité. Le roman ne propose aucun programme concret, mais il interdit de considérer l’état de fait comme un état de droit. Il souligne la fragilité d’une servitude qui peut cesser d’être volontaire. Le roman s’achève sur une lettre de Roxane, la femme aimée par Usbek, qui jette sa haine à la figure se son époux et proclame le choix amoureux qu’elle a fait d’un autre homme.
« Oui, je t’ai trompé ; j’ai séduit tes eunuques ; je me suis jouée de ta jalousie ; et j’ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs […] Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices ? que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d’affliger tous mes désirs ? / Non : j’ai pu vivre dans la servitude, mais j’ai toujours été libre : j’ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s’est toujours tenu dans l’indépendance. » (clxi).
Rythmée par les Oui et Non, la lettre sonne comme un discours. La récluse s’exprime en passionaria. La revendication d’une liberté intérieure, d’une indépendance morale, supérieure à toutes les servitudes politique et domestique, vaut pour les hommes comme pour les femmes. L’aveuglement d’Usbek conduit à l’explosion de son sérail, à une révolution, tandis que l’évolution morale de Rica aide à penser une libération des opprimées.
Il ne faut jamais oublier que, lorsque Montesquieu parle des femmes orientales, il évoque aussi les hommes occidentaux et que la Perse est un miroir qu’il tend aux Français. Quand il est question du voile dans les Lettres persanes, les lecteurs de 1721 pensent sans doute d’abord à la clôture monastique et aux vœux forcés. Ce voile, Jaucourt le définit dans l’Encyclopédie comme une « pièce de crêpe ou d’étoffe qui sert à couvrir la tête & une partie du visage ». Il poursuit : « Il y aurait bien des choses à dire sur le voile, soit au propre, comme littérateur, soit au figuré, comme chrétien, qui considère l’ état des filles qui prennent le voile, c’est-à-dire qui se font religieuses. » Il cite la diversité des coutumes religieuses et en vient à saint Paul qui décida que les hommes devaient prier la tête découverte, & que les femmes seraient voilées dans les temples. « Une chose bien singulière à l’égard des femmes : on suivait son précepte pour celles qui étaient veuves ou mariées, mais on en dispensa les filles, afin de les engager par cette marque d’éclat à prendre le voile spirituel, c’est-à-dire à se faire religieuses. » Mais Tertullien rappela que les femmes à l’église ne devaient pas tenter les anges et les filles durent aussi porter le voile. La question du voile oriental recouvre ces discussions de la France des Lumières, à la façon dont Voltaire vise surtout le catholicisme romain dans sa tragédie Mahomet ou le fanatisme, toute dédiée soit-elle à Benoît XIV ou justement parce qu’il pousse l’ironie à la dédier au souverain pontife.
Nous sommes souvent sommés aujourd’hui de choisir entre une bonne conscience occidentale qui aurait le monopole des valeurs et l’abandon de toute hiérarchie morale au nom de la diversité des cultures. Sommés aussi de choisir entre la nostalgie d’un passé idéalisé, garant de notre identité, et un progrès confondu avec le vertige quantitatif de la production et de la consommation. Le dilemme n’est pas entre le repli et la dissolution. Sans doute Montesquieu ni les philosophes des Lumières ne fournissent aucun réponse immédiate à nos interrogations, mais ils nous suggèrent de relativiser l’urgence du présent en le replaçant dans les leçons de l’histoire. Ils nous apprennent à transformer nos angoisses en inquiétudes : nos angoisses paralysantes, qui ne peuvent que répéter les traumatismes anciens, en inquiétudes dynamiques, ouvertes à l’invention de l’avenir. Au ressassement et au monologue, il faut préférer le dialogue et l’initiative créatrice. La critique des femmes voilées n’a d’efficace qu’à concerner aussi la situation faite aux femmes qui ne le sont pas. Les œuvres de Montesquieu et celles de Voltaire, de Rousseau et de Diderot ne sont pas destinées à nous ramener en arrière à une Europe qui parlait français, à un Ancien Régime tel que celui qui ne l’a pas connu ne sait pas ce qu’est le plaisir de vivre. Ils nous invitent à croire à l’histoire comme inventivité humaine et au progrès comme refus de la fatalité. En 1932, Ernst Cassirer publiait Die Philosophie der Aufklärung. Dès l’année suivante, la prise du pouvoir par Hitler ne frappait pas le livre d’illusion, elle marquait au contraire son actualité et son urgence. Telle est aussi la leçon aujourd’hui de Montesquieu dont l’un des fragments notés dans Mes Pensées reste saisissant : « Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je le regarderais comme un crime. » Telle est la hiérarchie des valeurs que nous rappellent les Lumières. Je vous remercie une fois encore vivement d’un prix et d’une référence qui prennent un sens et une résonance particuliers dans la France d’aujourd’hui.
Michel Delon